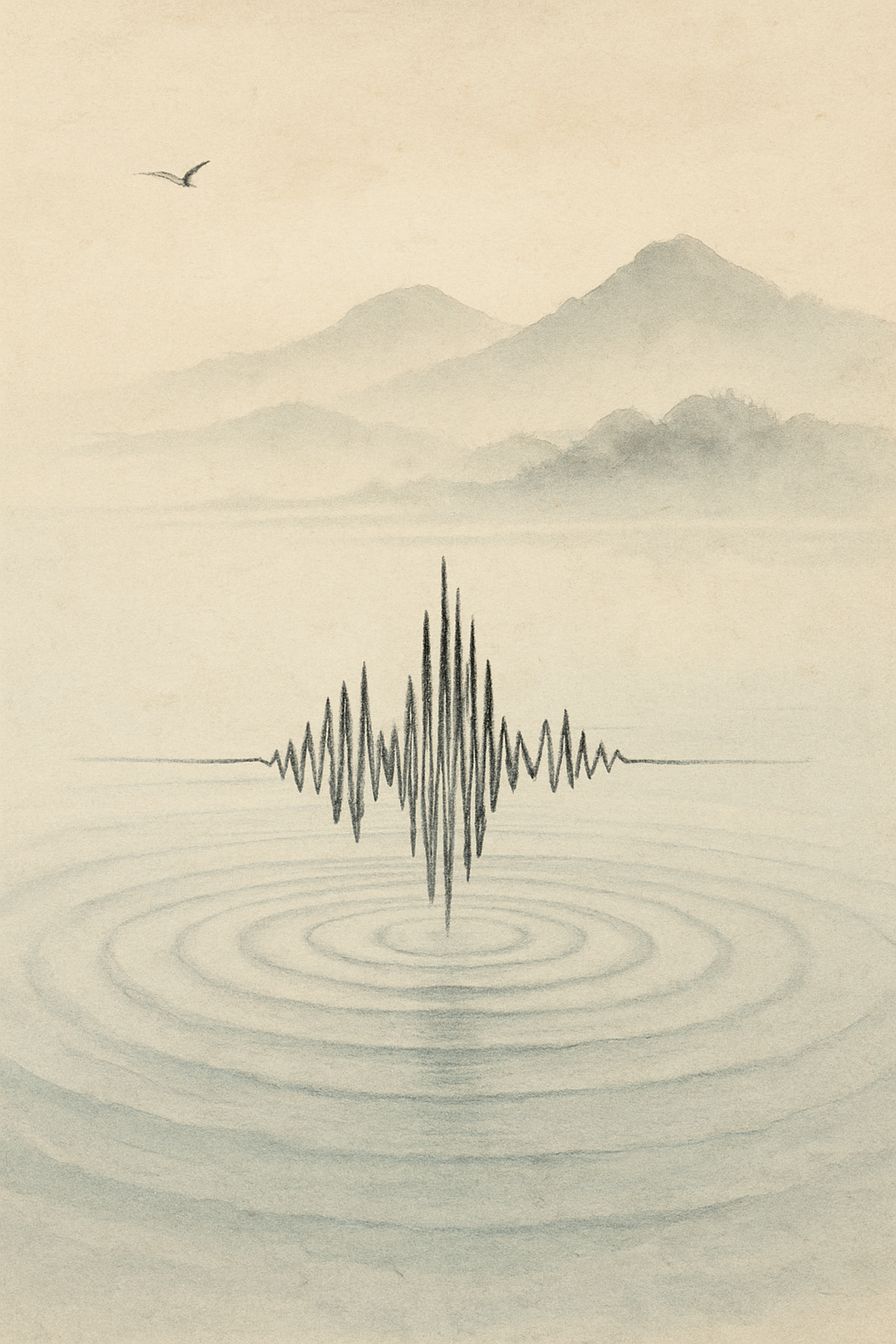Vers une écoute sensible des paysages sonores en santé intégrative
©NJ / Chat-Gpt
Nicolas Jaud, musicothérapeute, St-Nazaire (03/2025)
Dans le tumulte du monde contemporain, écouter devient un acte de soin. Et si les sons de la nature — le bruissement des feuilles, le chant d’un oiseau, le ressac de la mer — pouvaient apaiser le corps et l’esprit ? De plus en plus d’études scientifiques suggèrent que l’écoute des paysages sonores pourrait constituer une ressource thérapeutique précieuse. Ce texte explore les fondements cliniques, neurophysiologiques et sensibles de cette approche.
L’étude du paysage sonore en contexte thérapeutique nécessite de l’envisager non seulement comme un objet acoustique, mais également comme un phénomène perceptif et relationnel engageant une écoute sensible. Selon la définition fondatrice de R. Murray Schafer (1977), le paysage sonore désigne « tout ce qui est perçu ou entendu dans un environnement acoustique donné, que ce soit d’origine naturelle, humaine ou technologique ». Il comprend ainsi les sons caractéristiques d’un lieu à un moment donné, qu’ils soient issus du vivant (chants d’oiseaux, souffle du vent), de l’eau (ressac, ruisseau), ou d’activités humaines.
Dans une approche clinique, l’enjeu est d’explorer comment ces environnements sonores sont vécus par les sujets et peuvent influencer leur état physique et psychique. Un paysage sonore peut, par exemple, réactiver un souvenir apaisant, susciter une sensation de sécurité ou soutenir la régulation émotionnelle. Utilisés dans ce sens, ils deviennent des vecteurs d’ancrage psychocorporel, facilitant la détente, l’évocation de souvenirs positifs et le relâchement des tensions.
Dans ce contexte, l’écoute sensible devient centrale pour exploiter pleinement le potentiel thérapeutique des paysages sonores. Dès lors, le paysage sonore, lorsqu’il est abordé par l’écoute sensible, peut être envisagé comme une ressource thérapeutique dans une perspective de santé intégrative. Il constitue un médium non pharmacologique qui mérite d’être exploré pour son potentiel à soulager l’anxiété, moduler la perception de la douleur, restaurer un sentiment d’unité sensorielle et soutenir des processus de subjectivation : redevenir sujet de sa propre expérience, reconstruire une narration personnelle, reprendre un pouvoir d’agir sur son corps, sa santé, son environnement.
Définir l’écoute sensible
L’écoute sensible désigne une modalité d’attention non sélective et incarnée, sollicitant tout le corps et la conscience dans une posture réceptive. Il ne s’agit pas seulement d’entendre, mais de se laisser affecter par une présence acoustique, d’entrer dans une perception fine, incarnée et résonante, mobilisant mémoire sensorielle, émotion et imaginaire. Elle invite à ralentir, à habiter pleinement sa corporalité, à s’ouvrir à une dimension émotionnelle et, parfois, spirituelle. Dans cette expérience, l’écoute devient un acte relationnel : un contact vivant avec le monde sonore.
En contexte thérapeutique, cette posture peut induire des états modifiés de conscience (EMC) ou états non ordinaires (ENOC), tels que décrits dans la méditation, l’hypnose ou certaines formes de transe. Ces états se caractérisent par une attention focalisée, une perception altérée du temps et de l’espace, une sensation d’unité intérieure ou de présence augmentée. Écouter un paysage sonore — qu’il s’agisse d’un chant d’oiseau ou du bruissement des feuilles — devient alors un accès à une autre modalité d’être-au-monde, une disponibilité intérieure rare dans l’état de veille ordinaire.
Cette approche rejoint la pensée de la compositrice et pédagogue Pauline Oliveros, créatrice du concept de deep listening. Pour elle, « écouter profondément, c’est écouter de toutes les façons possibles tout ce qu’il y a à écouter, quelles que soient les circonstances, jusqu’à ce que l’écoute devienne un acte de pleine conscience » (Oliveros, 2005). Ses pratiques — soundwalks, méditations sonores, improvisations guidées — sont aujourd’hui reprises dans des contextes thérapeutiques ou préventifs. Comme l’écoute sensible, le deep listening cherche à instaurer une résonance avec le monde : « La manière dont nous écoutons est le reflet de notre façon d’être en relation avec le monde ».
Ainsi, l’écoute sensible se déploie comme une attention volontaire et ouverte à l’environnement sonore, impliquant le corps (posture, respiration, détente musculaire) et la disponibilité psychique, pour permettre au son d’induire des effets physiologiques (variabilité cardiaque, activité électrodermale), émotionnels (apaisement, évocation), cognitifs (mémoire, concentration) voire essentiels, avec un sentiment de connexion profonde, oubli de soi, expérience de plénitude. Dans un cadre clinique ou expérimental, cette transformation est objectivable par des indicateurs physiologiques, comportementaux ou subjectifs, attestant d’un changement d’état intérieur par résonance entre le sujet et son environnement sonore. Elle transforme notre état intérieur non par contrainte mais par résonance, faisant de l’acte d’écouter une expérience profonde de présence au monde. Cette conception rejoint, tout en l’adaptant au champ thérapeutique, la perspective de Hartmut Rosa sur la résonance : un lien vivant et transformateur avec ce qui nous entoure, qui ne se réduit ni à une simple perception, ni à une analyse technique, mais qui modifie notre façon d’être au monde.
L’écoute sensible dans la clinique de la douleur
Dans le cadre du traitement de la douleur chronique, l’écoute sensible agit comme un levier non médicamenteux de transformation : modulation des perceptions corporelles, diminution de l’hypervigilance, apaisement du système nerveux autonome, activation de souvenirs positifs, soutien émotionnel et spirituel. Par exemple, nous pouvons nous appuyer sur les résultats encourageants d’une étude réalisée en soins palliatifs à Saint-Nazaire (Antilogus, 2024), qui a mis en évidence une réduction significative de l’anxiété et du mal-être après une seule séance d’écoute de paysages sonores.
Au-delà des effets cliniques directs, cette approche ouvre un champ fertile de collaboration avec d’autres domaines scientifiques. L’écologie sonore et l’éco-acoustique apportent des outils pour caractériser les environnements naturels les plus bénéfiques. La psychologie appliquée permet d’explorer les mécanismes attentionnels et émotionnels en jeu lors de l’écoute. Les neurosciences, enfin, objectivent les réponses du cerveau et du système nerveux autonome à ces stimulations auditives.
Ces croisements disciplinaires ouvrent la voie à une ambition claire : inscrire l’écoute sensible des paysages sonores comme composante à part entière de la santé intégrative, en reconnaissant l’environnement sensoriel comme un facteur actif du soin. Il s’agit de structurer une approche à la fois scientifique et sensible de l’écoute en santé, à l’intersection du soin, de l’écologie et de la perception, et d’explorer les fondements d’une véritable « médecine de la relation au monde » par l’écoute.
Études scientifiques sur l’impact sur la santé
De nombreuses études indiquent que les sons de la nature ont des effets bénéfiques mesurables sur la santé psychologique et physique. La méta-analyse de Buxton, (2021) synthétise les données disponibles en concluant que l’exposition aux sons naturels améliore significativement la santé et l’humeur positive, tout en réduisant le stress et l’agacement. Elle précise également que les bruits d’eau (rivières, pluie, vagues) semblent produire les effets les plus marqués sur le bien-être affectif, tandis que le chant des oiseaux est particulièrement efficace pour atténuer le stress et l’irritation. Ces résultats confirment que les paysages sonores peuvent contribuer à diminuer l’anxiété et la tension psychologique en fournissant un environnement acoustique apaisant, à l’inverse du bruit urbain.
D’autres revues de littérature récentes, comme celle de Ratcliffe (2021) appuient également ces observations. Elle souligne que, de façon générale, après une situation de stress ou de fatigue, écouter des sons de la nature améliore l’humeur et les capacités cognitives tout en réduisant l’activation physiologique liée au stress. Les sons naturels (vent, oiseaux, eau) sont perçus comme restaurateurs : ils procurent du plaisir, de la détente, et aident les individus à récupérer d’un stress en diminuant l’état d’alerte de l’organisme.
En revanche, certaines études rapportent des résultats plus modérés ou variables selon les contextes, suggérant que l’effet peut dépendre de facteurs individuels (habitudes, préférences sonores, etc.). Néanmoins, le consensus général est que les paysages sonores ont un potentiel thérapeutique réel pour atténuer l’anxiété et le mal-être (Antilogus, 2024).
Sur le plan de la douleur, plusieurs travaux comme ceux de Bauer (2011) ont exploré l’intérêt des paysages sonores comme outil non médicamenteux. Par exemple, une étude contrôlée randomisée auprès de patients en postopératoire de chirurgie cardiaque a montré qu’écouter un programme mêlant musique douce et sons de la nature pendant vingt minutes, deux fois par jour, réduit significativement la douleur perçue par rapport au repos en silence. Dans ce groupe, on a également observé une détente accrue et une anxiété légèrement plus faible (bien que la diminution d’anxiété n’ait pas atteint le seuil de signification statistique). De même, en contexte de soins invasifs, une étude randomisée avant coloscopie de Küçükakça Çelika (2022) a mis en évidence qu’une diffusion de vingt minutes de sons naturels (bruits d’eau, forêt, oiseaux…) avant l’examen diminuait notablement l’anxiété et la douleur des patients par rapport au protocole standard. Les patients exposés aux paysages sonores présentaient non seulement moins d’anxiété pré-procédure, mais rapportaient aussi moins de douleur et d’embarras durant l’examen. Ces résultats rejoignent ceux obtenus en unité de soins intensifs ou en réanimation (Ruan, 2024) : l’ajout d’une thérapie sonore à base de sons de la nature — par exemple des enregistrements de forêts ou d’océan — a contribué à réduire l’agitation et améliorer le confort des patients.
En résumé, les données scientifiques existantes – comprenant des méta-analyses récentes, des revues systématiques et des essais contrôlés – convergent pour indiquer que l’écoute de paysages sonores peut apaiser l’anxiété, diminuer la perception de la douleur et réduire le stress. Ces effets ont été observés dans divers contextes : population générale (amélioration de l’humeur, diminution du stress quotidien), patients hospitalisés (réduction de la douleur post-chirurgicale et de l’anxiété pré-procédure), et même en soins palliatifs comme on le verra plus loin. Cette base d’évidence soutient l’intégration de telles approches sonores dans une stratégie de santé intégrative, en complément des traitements conventionnels.
Intégration des paysages sonores en milieu médical
L’usage thérapeutique des paysages sonores commence à se répandre dans divers environnements de soins, des hôpitaux généraux aux unités spécialisées (soins palliatifs, psychiatrie, etc.). Plusieurs méthodes d’intégration sont employées, allant des séances individuelles encadrées par un musicothérapeute à l’aménagement sonore des espaces hospitaliers.
Musicothérapie réceptive en soins palliatifs : En unités de fin de vie, où le bien-être psychologique est primordial, des thérapeutes utilisent l’écoute de sons de la nature pour soulager les patients. Par exemple, une étude conduite en unité de soins palliatifs à Saint-Nazaire (Antiligus, 2024) a proposé à des patients atteints de maladies incurables des séances de musicothérapie basées sur des paysages sonores. Le patient, confortablement installé, écoutait pendant un temps choisi (souvent 20-30 minutes) un enregistrement de nature (au choix : chant d’oiseaux, forêt, bord de mer, etc.), le tout guidé par le musicothérapeute présent. Les résultats sont probants : après une seule séance, l’anxiété des patients a diminué d’environ 34 % en moyenne (p = 0,032) et leur sentiment de mal-être de 43 % (p = 0,0012), avec une tendance générale à l’amélioration pour tous les symptômes mesurés.
Outre ces chiffres encourageants, les comptes-rendus qualitatifs soulignent que les patients se sentent plus détendus et relaxés, certains évoquent des souvenirs personnels liés à ces sons, et beaucoup parlent d’une véritable “reconnexion avec la nature” malgré leur hospitalisation. Cette pratique, encore émergente, semble donc offrir aux personnes en fin de vie un espace d’évasion sensorielle et de soulagement, sans effets indésirables.Ambiance sonore apaisante dans les hôpitaux : Dans les services hospitaliers conventionnels, le défi est souvent de contrer le bruit ambiant (machines, alarmes, conversations) qui génère du stress. Certaines institutions ont commencé à introduire des paysages sonores diffusés en arrière-plan pour améliorer l’atmosphère. Par exemple, quelques hôpitaux diffusent de légers sons de nature, comme du chant d’oiseaux, pour contrebalancer le vacarme technologique des moniteurs et alarmes (Bates, 2021). L’idée est de créer une ambiance plus sereine et biophilique dans les couloirs, salles d’attente ou même certaines chambres, afin de réduire l’anxiété des patients (et du personnel) liée au bruit hospitalier. Par ailleurs, de nombreux établissements instaurent des périodes de silence ou de calme (souvent l’après-midi ou la nuit) durant lesquelles on limite les nuisances sonores. Lors de ces plages de quiétude, on peut utiliser un fond sonore naturel pour masquer les bruits ponctuels restants. Ce type d’intervention acoustique a montré des bénéfices : instaurer des temps calmes et employer un masquage sonore naturel contribue à créer un espace de repos plus propice au sommeil et à la détente des patients (Busch-Vishniac, 2019). Même si le niveau sonore mesuré (en décibels) ne change pas drastiquement, la perception du cadre devient plus agréable et moins stressante, comme l’ont noté certaines équipes soignantes.
Applications en psychiatrie et en soins de santé mentale : Les paysages sonores trouvent également leur place dans les environnements de santé mentale, où ils peuvent contribuer à apaiser les patients anxieux ou agités. Par exemple, dans les jardins thérapeutiques de cliniques psychiatriques, on intègre souvent des éléments sonores naturels : fontaines, dispositifs imitant le bruit d’un ruisseau, ou nichoirs à oiseaux pour favoriser la présence de chants naturels. Une étude coréenne sur un jardin de réhabilitation psychiatrique a montré que les patients schizophrènes appréciaient tout particulièrement le son de l’eau courante et le gazouillis des oiseaux, jugés plaisants et stimulants, alors que des sons additionnels — comme des carillons éoliens ou de la musique — n’étaient pas forcément nécessaires (Ahn, Deug-Soo, 2015). L’eau ressort comme le son favori apportant à la fois calme et vitalité chez ces patients, tandis qu’une musique d’ambiance augmente surtout la tranquillité ressentie. Ces enseignements guident les concepteurs d’espaces de soins : un « bruit d’eau doux » en fond dans une salle de relaxation ou « un enregistrement de forêt » diffusé dans une pièce de repos peuvent aider les patients psychiatriques à se relaxer, sans les sur-stimuler. Par ailleurs, en pédopsychiatrie ou dans la prise en charge du stress post-traumatique, des exercices d’écoute guidée de sons naturels (en groupe ou en individuel) sont parfois proposés comme forme de méditation sonore, aidant les patients à se recentrer et à se calmer.
Ainsi, les pratiques actuelles intégrant les paysages sonores en milieu médical vont de l’intervention individualisée, comme une séance de musicothérapie réceptive au casque avec un choix personnalisé du paysage sonore diffusé, à l’aménagement environnemental, telle la diffusion continue ou programmée de sons naturels dans l’espace de soin. Les applications concrètes en médecine intégrative se multiplient : soutien des patients en fin de vie, réduction de l’anxiété préopératoire, amélioration du confort en réanimation, création d’environnements de guérison en psychiatrie, etc. Toutes ont en commun d’exploiter la puissance apaisante du « grand orchestre » de la nature — pour reprendre les mots de Bernie Krause (2016) — pour compléter l’arsenal thérapeutique non-médicamenteux.
Dispositifs immersifs et nouvelles technologies
L’essor des technologies immersives a ouvert de nouvelles possibilités pour profiter des paysages sonores de manière plus engageante et efficace. Plusieurs dispositifs innovants sont expérimentés afin de plonger les patients dans des univers sonores relaxants tout en s’adaptant aux contraintes du milieu médical :
Réalité virtuelle (VR) et environnements immersifs : La VR permet de diffuser simultanément des images apaisantes et des sons naturels en 360°, créant une immersion complète. Des essais cliniques ont montré des résultats prometteurs. Par exemple, lors d’examens médicaux douloureux comme l’hystérosalpingographie, le port d’un casque VR diffusant une scène naturelle (forêt, plage) accompagnée de sons de la nature a significativement réduit la douleur perçue et l’anxiété par rapport au groupe témoin (Baltaci, 2024). Écouter uniquement les sons de la nature apportait déjà un bénéfice notable, mais l’ajout de l’immersion visuelle amplifiait encore l’effet analgésique et anxiolytique.
De même, des hôpitaux utilisent la VR avec contenu naturel pour la gestion de la douleur aiguë (soins de brûlures, pansements) ou pour la détente des patients en chimiothérapie. Ces environnements virtuels, sollicitant fortement la vision et l’audition, détournent l’attention de la douleur et de l’angoisse — un mécanisme de diversion cognitive complémentaire aux effets thérapeutiques des sons.Enceintes directionnelles et sonorisation ciblée : Dans un espace partagé, tout le monde n’a pas les mêmes besoins sonores au même moment. Les haut-parleurs directionnels (ex. Audio Spotlight) projettent le son de façon ciblée, créant une bulle sonore privée pour un patient sans gêner les autres. Cette technologie, adoptée dans certains hôpitaux, diffuse musique ou sons de nature sans imposer de casque, améliorant l’expérience individuelle tout en préservant le calme environnant.
Thérapies sonores interactives et biofeedback : Plutôt que de recevoir passivement un paysage sonore, certaines approches invitent le patient à composer son environnement sonore en temps réel. L’initiative My Soundscape permet, par exemple, d’ajouter ou de retirer certains sons (pluie, oiseaux, vent) pour personnaliser l’expérience. Des dispositifs de biofeedback vont plus loin : un capteur de respiration ou de fréquence cardiaque module l’intensité, le tempo ou la spatialisation des sons, incitant à ralentir le souffle ou à s’apaiser. Cette boucle sensorielle fermée renforce la conscience de soi : l’utilisateur entend littéralement son propre apaisement se refléter dans le paysage sonore.
Des prototypes récents, comme l’application Prelude (Greenberg, 2021), montrent qu’une expérience sonore immersive et interactive, associée à des paramètres physiologiques, peut réduire significativement le stress et les affects négatifs. Ces outils trouvent naturellement leur place dans les espaces multisensoriels thérapeutiques, tels que les salles Snoezelen, où sons, lumières et textures coexistent dans une scénographie adaptée à la stimulation douce.
Les perspectives offertes par ces dispositifs sont considérables. En croisant biofeedback, design sonore adaptatif, spatialisation auditive et technologies haptiques, on entrevoit la possibilité de créer de véritables écosystèmes sonores intelligents, capables de résonner avec l’état intérieur du patient. Ces innovations invitent à penser le soin comme une expérience sonore évolutive, où la technologie devient partenaire de la relation thérapeutique, en articulant dimensions artistiques, neuroscientifiques et environnementales.
Comparaison avec d’autres approches de musicothérapie
Les paysages sonores s’inscrivent dans le panorama plus large des thérapies par la musique et le son. Il est utile de comparer cette méthode à d’autres approches non médicamenteuses apparentées, afin d’en cerner les similarités et spécificités.
Premièrement, concernant la musicothérapie réceptive face à l’écoute de paysages sonores, dans les deux cas, le patient est en position d’écoute passive d’un contenu sonore choisi pour son effet apaisant ou expressif. La musicothérapie réceptive classique fait appel à des morceaux de musique (instrumentale ou vocale), qui peuvent être des chansons connues du patient ou des musiques spécialement composées. L’écoute de paysages sonores, elle, privilégie des enregistrements d’environnements naturels ou quotidiens. La similarité principale est l’objectif de détente et de modulation de l’humeur via le son : ainsi, écouter un adagio de Mozart ou une pluie d’orage dans une forêt vise à réduire le stress et apporter du réconfort. Des méta-analyses confirment d’ailleurs l’efficacité de la musicothérapie réceptive sur l’anxiété et la douleur — par exemple, la revue Cochrane a montré que l’écoute musicale améliore les symptômes psychologiques et physiques chez les patients cancéreux (Köhler, 2021).
La différence, cependant, tient à la nature du stimulus sonore : une musique est structurée (mélodie, harmonie, rythme) et peut évoquer des émotions intenses ou des souvenirs personnels (surtout si le morceau est significatif pour le patient). À l’inverse, un paysage sonore est généralement dépourvu de structure musicale formelle : c’est un flux d’ambiances sonores aléatoires ou cycliques (le ressac des vagues, le crépitement du feu...). Cette neutralité musicale fait que les paysages sonores sont souvent perçus comme plus neutres culturellement et émotionnellement. Ils risquent moins de déclencher une émotion intense — comme la tristesse liée à un souvenir précis, par exemple — ce qui peut être un avantage chez certains patients vulnérables. En soins palliatifs, ce choix est délibéré : des thérapeutes notent que des chansons aimées peuvent parfois provoquer une trop forte charge émotionnelle ou une nostalgie douloureuse, là où un son de nature apporte du calme sans tristesse associée. En somme, paysages sonores et musiques douces poursuivent un but commun (relaxation, bien-être) et peuvent se combiner, mais le paysage sonore offre un fond auditif plus environnemental qu’artistique, souvent utilisé quand on souhaite une atmosphère apaisante sans message ou mélodie particulière.
L’écoute de sons binauraux est aujourd’hui populaire. Elle consiste à faire entendre à l’oreille gauche et à l’oreille droite deux fréquences légèrement différentes (par exemple 210 Hz et 200 Hz), de sorte que le cerveau perçoive un battement correspondant à la différence entre ces fréquences (ici 10 Hz). Ce phénomène, appelé battement binaural, vise à synchroniser l’activité cérébrale sur certaines ondes — alpha pour la relaxation, thêta pour la méditation, etc. Des études pilotes et quelques essais suggèrent que l’écoute régulière de battements binauraux peut réduire l’anxiété et favoriser la relaxation. Par exemple, une revue de 2019 indique qu’une exposition prolongée à ces sons est associée à une diminution significative de l’anxiété chez les participants (Medical News Today).
La différence principale avec les paysages sonores réside dans la nature du stimulus : les sons binauraux n’ont pas de signification naturelle ou musicale. Ce sont des bourdonnements artificiels, souvent masqués derrière du bruit blanc ou une musique légère, qui agissent surtout par un mécanisme neurophysiologique — « entraîner » le cerveau à un certain rythme — plutôt que par une évocation émotionnelle ou cognitive. À l’inverse, un paysage sonore agit via les réponses émotionnelles et imaginaires qu’il suscite, grâce à sa connexion avec des environnements évocateurs. Certains protocoles combinent les deux : par exemple, écouter une pluie tropicale relaxante avec un battement binaural delta à 2 Hz pour favoriser le sommeil profond. En résumé, binaural et paysages sonores peuvent être complémentaires : le premier agit sur la synchronisation cérébrale, le second sur l’immersion sensorielle et l’apaisement émotionnel.
Ensuite, il existe également en musicothérapie des pratiques actives utilisées dans le cadre de l’accompagnement de patients douloureux. Parmi elles, le chant des voyelles tel qu’il est proposé dans le protocole d’Exploration vocale (Jaud, 2021). Ici, le patient produit lui-même le son avec sa voix, souvent accompagné ou guidé par un thérapeute. Les similarités avec l’écoute de paysages sonores résident dans le fait que les deux méthodes cherchent à apaiser l’esprit et réguler les émotions par le son – chanter une berceuse douce ou écouter le murmure du vent peuvent tous deux calmer l’anxiété, ralentir le rythme cardiaque et induire une détente. Toutefois, le chant engage des mécanismes différents : il mobilise la respiration, qui se synchronise à la phrase musicale, la posture, et l’expression personnelle. De ce fait, ce chant thérapeutique peut avoir des bienfaits supplémentaires, comme stimuler le nerf vague et la cohérence cardiaque via la respiration profonde, ou favoriser la libération d’ocytocine (hormone liée à l’attachement et à l’apaisement) – on a par exemple mesuré qu’écouter de la musique apaisante ou chanter peut augmenter les niveaux d’ocytocine chez les patients post-opératoires, suggérant une baisse de stress biologique (Bauer, 2011).
Le chant en groupe crée aussi du lien social, de la joie partagée, ce que n’apporte pas une écoute au casque solitaire. En contrepartie, chanter demande un effort et de la volonté, ce qui n’est pas toujours accessible aux patients fatigués ou douloureux (d’où la préférence pour l’écoute passive en contexte de soins palliatifs, où la musicothérapie active est souvent difficile à mettre en place chez des patients très affaiblis.
En définitive, le chant réalisé dans un cadre thérapeutique et l’écoute de paysages sonores visent tous deux un état de relaxation et de mieux-être, mais le chant passe par l’activité vocale et l’expression de soi, là où l’écoute passe par la réception sensorielle et l’imaginaire. Suivant l’état et les préférences du patient, l’une ou l’autre méthode sera privilégiée – et il est tout à fait possible de les combiner : par exemple, un thérapeute pourrait inviter le patient à chanter doucement avec le son de la pluie en fond, transformant le paysage sonore en support à l’expression vocale.
Ainsi, on peut dire que l’écoute de paysages sonores se positionne comme une modalité de musicothérapie réceptive particulière, centrée sur les sons de la nature plutôt que sur la musique au sens strict. Elle partage avec les autres thérapies sonores l’objectif de soulager sans médicaments en utilisant le canal auditif, mais s’en distingue par son contenu acoustique spécifique et par le degré d’engagement requis du patient (passif vs actif). Dans une optique de médecine intégrative, ces approches ne s’excluent pas mais se complètent – un patient anxieux pourrait par exemple bénéficier de sons binauraux pour s’endormir, de promenades sonores en forêt pour se ressourcer le week-end, d’écoutes de musiques aimées pour le soutenir moralement, et de quelques sessions de chant guidé pour libérer ses émotions. Le paysage sonore offre une palette supplémentaire dans l’arsenal de la thérapie par le son, particulièrement adaptée à ceux qui cherchent le calme de la nature en eux.
Effets de l’écoute consciente des paysages sonores
Du point de vue des neurosciences, l’écoute consciente de paysages sonores agit à plusieurs niveaux : attentionnel, émotionnel, et neurophysiologique. Les recherches en psychologie environnementale proposent deux cadres théoriques majeurs pour expliquer les bienfaits constatés : l’un axé sur l’attention, l’autre sur le stress.
Selon la théorie de la restauration de l’attention (Attention Restoration Theory, ART), élaborée par Kaplan (1995), la nature possède la capacité de capter notre attention de manière douce et non invasive, ce qui permet à notre attention dirigée (volontaire), habituellement très sollicitée, de se reposer (Buxton, 2021). Contrairement à un environnement urbain bruyant qui exige une vigilance constante et épuise nos ressources cognitives, un environnement naturel (y compris sonore) n’exige pas d’effort mental soutenu – on peut écouter le chant des oiseaux sans concentration intense – et cela ressource nos capacités attentionnelles. En parallèle, la théorie de la récupération du stress (Stress Recovery Theory, Ulrich) propose que les milieux naturels induisent automatiquement une réponse de détente : ils sont perçus par notre cerveau limbique comme moins menaçants, car liés à un contexte d’évolution sécurisant (eau, abri, absence de prédateur), ce qui entraîne une diminution de l’activation de l’axe du stress (Ibid.)
Concrètement, face à des sons de nature, le corps aurait tendance à activer le système nerveux parasympathique (rythme cardiaque ralenti, muscles détendus) plutôt que le système sympathique de « lutte ou fuite » responsable des montées de cortisol et de fréquence cardiaque en cas de danger. Ces théories expliquent pourquoi écouter un environnement naturel, en pleine conscience, pourrait simultanément reposer l’esprit (améliorer l’attention, la mémoire de travail) et apaiser l’émotionnel (réduire l’anxiété et l’hypervigilance).
Les études de neuro-imagerie et de physiologie apportent des preuves tangibles de ces effets. Une expérience remarquable a consisté à faire écouter à des volontaires des bandes sonores soit naturelles, soit artificielles/bruit urbain, pendant qu’ils passaient une IRM fonctionnelle et qu’on mesurait leurs signes vitaux. Les résultats, publiés en 2017, montrent que le cerveau ne réagit pas du tout de la même façon selon le type de son écouté (Gould van Praag, 2017).
Avec les sons naturels, l’IRM réalisée dans cette étude a révélé une connectivité fonctionnelle indiquant une orientation de l’attention vers l’environnement externe, cohérente avec un état d’éveil calme et curieux. En revanche, sous l’écoute de bruits urbains artificiels, la connectivité cérébrale bascule vers un focus interne, semblable à celui qu’on observe dans des états d’anxiété, de rumination ou de dépression. En d’autres termes, le bruit amène le cerveau à se replier sur une activité interne négative, alors que les sons de nature favorisent une ouverture au monde et à l’instant présent – exactement ce que vise la pleine conscience. Par ailleurs, cette étude a mesuré une différence au niveau du système nerveux autonome : écouter la nature augmentait l’activité du système parasympathique “repos-digestion” (associée au calme et à la relaxation) par rapport aux sons urbains, qui eux maintenaient davantage l’alerte du système fight-or-flight (combat-fuite). Fait remarquable, les participants étaient également soumis à une tâche d’attention simple pendant l’IRM : leurs performances à cette tâche de vigilance étaient meilleures après avoir écouté les sons naturels, confirmant l’effet restaurateur sur l’attention. Ainsi, on observe simultanément un apaisement physiologique et une amélioration cognitive sous l’influence des paysages sonores.
D’autres mesures neurophysiologiques corroborent ces observations. Dans une étude japonaise (Jo et al., 2019), on a comparé l’effet d’un paysage sonore de forêt à celui d’un environnement sonore urbain sur de jeunes adultes en enregistrant leur activité cérébrale par near-infrared spectroscopy (NIRS) et leur rythme cardiaque. L’exposition au son de la forêt a entraîné une diminution de l’activité du cortex préfrontal (baisse de la concentration d’oxyhémoglobine dans cette région liée au stress et au contrôle exécutif) par rapport au son de la ville. En parallèle, les marqueurs du stress physiologique se sont améliorés : réduction du ratio LF/HF de la variabilité cardiaque (signe d’une moindre activation sympathique) et baisse du pouls. Les participants ont aussi qualifié le son naturel de bien plus confortable et relaxant que le bruit urbain Ces données objectives indiquent que même en quelques minutes, une immersion sonore naturelle peut ramener le cerveau et le corps vers un état de relaxation mesurable (baisse de la fréquence cardiaque, du tonus vasomoteur, de l’activité préfrontale), ce qui correspond à un état mental plus serein et moins anxieux.
Écouter consciemment un paysage sonore, c’est aussi exercer une forme de méditation par le son. En pratique, on recommande souvent aux patients ou participants de porter toute leur attention sur les sons qu’ils entendent, d’en noter les textures, les variations, sans porter de jugement. Cet ancrage attentionnel sur le présent fonctionne de façon analogue à la pleine conscience focalisée sur la respiration ou sur des sensations corporelles. Il aide à rompre le cycle des pensées ruminatives en ramenant l’attention à un stimulus sensoriel immédiat. Des professionnels en santé mentale intègrent par exemple des promenades sonores (soundwalks) en thérapie, où l’on entraîne la personne à marcher en nature en se concentrant sur l’environnement acoustique, ce qui développe son attention au présent et diminue son stress perçu (Buxton, 2021).
Les effets sur le bien-être comprennent une meilleure régulation émotionnelle : au lieu de se laisser envahir par des émotions négatives ou des peurs, le patient apprend à les laisser passer en revenant aux sons apaisants autour de lui. Cela peut se traduire par une baisse de l’anxiété à long terme et une amélioration de la résilience au stress.
Enfin, l’évocation de souvenirs positifs par les paysages sonores est un aspect parfois rapporté, notamment en gériatrie ou soins palliatifs. Un son de mer peut rappeler au patient ses vacances d’enfance, le chant des cigales lui remémorer un été insouciant… Ces réminiscences sonores, quand elles surviennent, ont souvent une valeur émotionnelle positive et peuvent contribuer au bien-être en activant des mémoires agréables. Dans l’étude en soins palliatifs déjà citée, plusieurs patients ont témoigné que les sons de nature leur ont fait surgir des souvenirs personnels heureux et des émotions douces liés à leur histoire de vie (Antilogus, 2024).
Cette réactivation mnésique peut être thérapeutique en fin de vie, aidant le patient à faire le lien avec des expériences significatives, à communiquer ces souvenirs aux proches ou aux soignants, voire à trouver une certaine paix intérieure (par exemple en se projetant mentalement dans un lieu familier et rassurant évoqué par le son). Sur le plan cognitif, on sait que les indices sensoriels (odeurs, musiques, sons) sont de puissants déclencheurs de mémoire autobiographique : utilisés de manière appropriée, les paysages sonores peuvent ainsi soutenir la mémoire chez les personnes âgées et apporter un sentiment d’identité et de continuité de soi, ce qui contribue indirectement à leur bien-être psychique.
Ainsi, l’écoute consciente de paysages sonores agit comme un « nectar » pour le cerveau fatigué ou stressé : elle rééquilibre l’activité neuronale en favorisant des réseaux associatifs externes plutôt que les réseaux de rumination interne. Elle active les systèmes de détente du corps (parasympathique), améliore l’attention et possiblement certaines fonctions cognitives exécutive, et stabilise les émotions (diminution de l’anxiété, augmentation des affects positifs). Ces effets, objectivés par les neurosciences et la psychologie expérimentale, apportent une crédibilité scientifique forte à l’utilisation des paysages sonores en médecine intégrative. Ils expliquent pourquoi tant de personnes rapportent un profond sentiment de calme en écoutant la pluie tomber ou le feu crépiter : ce ne sont pas juste des impressions subjectives, mais bien le reflet d’ajustements neurophysiologiques concrets conduisant à un état de bien-être accru.
En conclusion
L’ensemble de ces recherches et pratiques démontre que l’écoute thérapeutique des paysages sonores constitue un outil prometteur en santé intégrative et en thérapies non médicamenteuses. Sur le plan scientifique, les paysages sonores se révèlent capables de soulager l’anxiété, la douleur et le stress dans des contextes variés, appuyés par des données cliniques et neurobiologiques robustes (Buxton, 2021 ; Bauer, 2011). Ils s’intègrent aussi bien dans des séances individuelles de musicothérapie que dans des dispositifs immersifs ou des environnements sonorisés collectifs.
Sur le plan pratique, ces interventions sont accessibles, peu coûteuses et aisément adaptables. Elles peuvent prendre la forme d’une écoute au casque en soins palliatifs, de la diffusion de sons naturels dans des espaces hospitaliers, ou encore d’une immersion en réalité virtuelle pour détourner l’attention lors d’une procédure douloureuse. Comparée à d’autres approches sonores (musique, chant, stimulation binaurale), l’écoute de paysages sonores offre une expérience sensorielle particulière, souvent perçue comme plus neutre, universelle et évocatrice de notre lien ancestral avec le vivant. Elle s’intègre harmonieusement à une stratégie globale de musicothérapie.
Loin d’être une simple distraction agréable, l’écoute sensible de ces environnements naturels se révèle être une voie thérapeutique à part entière. Fondée sur des mécanismes psychologiques (évocation, attention flottante, méditation) et physiologiques (activation parasympathique, synchronisation cérébrale), elle engage le patient dans une relation vivante au monde. Cette démarche rejoint les travaux du sociologue Hartmut Rosa, pour qui la qualité de notre lien au monde – et plus encore l’expérience de résonance – constitue un levier essentiel de santé, de vitalité et de transformation. Écouter un paysage sonore ne revient pas à percevoir un objet acoustique : c’est répondre à un appel du monde, s’y relier, s’y accorder.
Enfin, cette dynamique ouvre des perspectives fécondes pour la recherche. Des opportunités de collaboration s’esquissent. En croisant écologie sonore, neurosciences auditives et pratiques de soin, il devient possible de penser des dispositifs thérapeutiques fondés à la fois sur des réponses neurophysiologiques objectivables et sur une expérience subjective incarnée. Cette approche interdisciplinaire pourrait permettre de modéliser des environnements sonores de soin résonnant avec l’histoire perceptive et émotionnelle du sujet. Elle s’inscrit pleinement dans une vision de la santé intégrative, où les sciences du son rencontrent les enjeux cliniques pour renouveler nos façons d’écouter, de soigner, et d’habiter le monde.
Je mène actuellement des travaux de recherche clinique sur l’impact de l’écoute de paysages sonores en unité de soins palliatifs, en lien avec le GIPSA-Lab et le CH de Saint-Nazaire. Cette réflexion s’inscrit dans un engagement plus large pour une médecine sensible et relationnelle.
Bibliographie
Becker J. (2004). Deep Listeners : Music, Emotion, and Trancing. Indiana University Press
Pavlicevic M, Impey A. Deep listening: towards an imaginative reframing of health and well-being practices in international development. Arts Health. 2013 Aug 13;5(3):238-252. doi: 10.1080/17533015.2013.827227. PMID: 25729413; PMCID: PMC4340541.
Moin, F.K.T., Itzchakov, G., Kasriel, E. and Weinstein, N. (2025), Deep Listening Training to Bridge Divides: Fostering Attitudinal Change through Intimacy and Self-Insight. Journal of Applied Social Psychology. https://doi.org/10.1111/jasp.13086
Buxton RT, Pearson AL, Allou C, Fristrup K, Wittemyer G. A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Apr 6;118(14):e2013097118. doi: 10.1073/pnas.2013097118. PMID: 33753555; PMCID: PMC8040792.
Ratcliffe E. Sound and Soundscape in Restorative Natural Environments: A Narrative Literature Review. Front Psychol. 2021 Apr 26;12:570563. doi: 10.3389/fpsyg.2021.570563. PMID: 33981262; PMCID: PMC8107214.
Bauer BA, Cutshall SA, Anderson PG, Prinsen SK, Wentworth LJ, Olney TJ, Messner PK, Brekke KM, Li Z, Sundt TM 3rd, Kelly RF, Bauer BA. Effect of the combination of music and nature sounds on pain and anxiety in cardiac surgical patients: a randomized study. Altern Ther Health Med. 2011 Jul-Aug;17(4):16-23. PMID: 22314630.
Antilogus A. (2024). Musicothérapie en Unité de Soins Palliatifs : impact des paysages sonores sur les symptômes. Mémoire FST Soins Palliatifs, 9/11/24. Faculté de médecine, Université de Nantes.
KÜÇÜKAKÇA Çelik G., PALABIYIK Yilmaz D., ÖZER N., ERDAĞI ORAL S. (2022). The Effect of Nature-Based Sounds Applied Before Colonoscopy on Patients’ Pain, Anxiety, and Embarrassment: A Randomized Controlled Study. Journal of Traditional Medical Complementary Therapies. 5/3. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-the-effect-of-nature-based-sounds-applied-before-colonoscopy-on-patients-pain-anxiety-and-embarrassment-a-randomized-controlled-study-99967.html
Qianwen Ruan, Chuanxiong Li, Meihua Qiu, Linjun Wan, Tong Sun. Effects of Natural Sound Therapy on Pain and Agitation Induced by Endotracheal Suctioning: A Real-World Study. Am J Crit Care 1 July 2024; 33 (4): 299–303. doi: https://doi.org/10.4037/ajcc2024570
Bates V. (2021). How the noises of a hospital can become a healing soundscape. Psyche. https://psyche.co/ideas/how-the-noises-of-a-hospital-can-become-a-healing-soundscape. Consulté 30/3/25.
Busch-Vishniac I., Reheard E. (2019). Hospital Soundscapes: Characterization, Impacts, and Interventions. Acoustical Society of America. Acoustical Society of Americaeserved. https://doi.org/10.1121/AT.2019.15.3.11
Ahn, Deug-Soo. (2015). Analyses on Sound Effects for Soundscape Design of Healing Garden at Psychiatric Hospitals - Focused Psychological and Physiological Effects -. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture. 43. 82-95. 10.9715/KILA.2015.43.1.082.
Krause B. (2016). Le Grand Orchestre des Animaux : catalogue de l’exposition. Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris.
Baltaci N, Bal S, Koç E, Edis EK. Effects of virtual reality and nature sounds on pain and anxiety during hysterosalpingography: a randomized controlled trial. Rev Assoc Med Bras (1992). 2024 Aug 16;70(7):e20231599. doi: 10.1590/1806-9282.20231599. PMID: 39166658; PMCID: PMC11329239.
Bates V. (2021). Making Noise in the Modern Hospital. Cambridge University Press, London.
Greenberg, David & Bodner, Ehud & Shrira, Amit & Fricke, Kai. (2021). Decreasing Stress Through a Spatial Audio and Immersive 3D Environment: A Pilot Study With Implications for Clinical and Medical Settings. Music & Science. 4. 205920432199399. 10.1177/2059204321993992.
Jaud N. (2020). À la recherche de la voix perdue : une musicothérapie en addictologie. Revue française de musicothérapie, Association française de musicothérapie, 2020, 39 (2). ⟨hal-03432804⟩
Bauer BA, Cutshall SA, Anderson PG, Prinsen SK, Wentworth LJ, Olney TJ, Messner PK, Brekke KM, Li Z, Sundt TM 3rd, Kelly RF, Bauer BA. Effect of the combination of music and nature sounds on pain and anxiety in cardiac surgical patients: a randomized study. Altern Ther Health Med. 2011 Jul-Aug;17(4):16-23. PMID: 22314630.
Kaplan S. A., The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. J. Environ. Psychol. 15, 169–182 (1995).
Gould van Praag, C., Garfinkel, S., Sparasci, O. et al. Mind-wandering and alterations to default mode network connectivity when listening to naturalistic versus artificial sounds. Sci Rep 7, 45273 (2017). https://doi.org/10.1038/srep45273
Jo H, Song C, Ikei H, Enomoto S, Kobayashi H, Miyazaki Y. Physiological and Psychological Effects of Forest and Urban Sounds Using High-Resolution Sound Sources. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jul 24;16(15):2649. doi: 10.3390/ijerph16152649. PMID: 31344973; PMCID: PMC6695879.
Rosa H. (2018). Résonance : une sociologie de la relation au monde. La Découverte, Paris.
Rosa H. (2023). Rendre le monde indisponible, La Découverte, Paris.